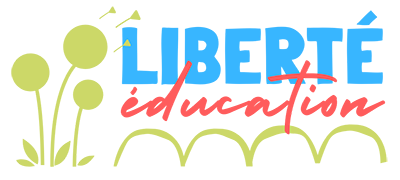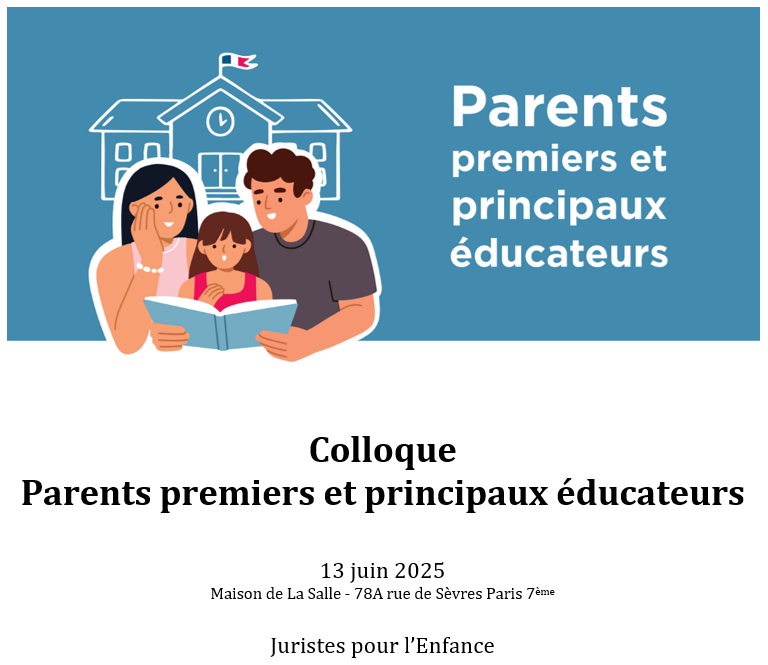 Le Président de notre association, Me Hubert Veauvy, est intervenu (voir vidéo ci-dessous) au sujet de l’instruction en famille lors d’un colloque organisé par l’association Juristes pour l’enfance, qui s’est tenu à Paris le 13 juin 2025 sur le thème Parents : premiers et principaux éducateurs.
Le Président de notre association, Me Hubert Veauvy, est intervenu (voir vidéo ci-dessous) au sujet de l’instruction en famille lors d’un colloque organisé par l’association Juristes pour l’enfance, qui s’est tenu à Paris le 13 juin 2025 sur le thème Parents : premiers et principaux éducateurs.
Une question qui semble familière, évidente même : qui d’autres que les parents pourraient bien être les premiers et principaux éducateurs des enfants ? Pourtant, à travers le nouveau régime d’interdiction partielle de la liberté d’instruire en famille, c’est bien ce fondement même qui a été atteint.
Pourquoi ce colloque ?
Aude Mirkovic Juriste et Présidente de Juristes pour l’enfance, exposait d’ailleurs les raisons et les buts de colloque : apporter réflexion, expertise et solutions en présence de deux tendances :
– la tendance à vouloir émanciper les enfants de l’autorité parentale, sous prétexte de leur donner de l’autonomie, comme si l’autorité parentale était un carcan liberticide.
– la tendance à disqualifier les parents dans leur rôle éducatif pour les remplacer par l’Etat, notamment dans le cadre scolaire.
En effet, selon elle, libérer l’enfant d’une prétendue oppression le prive de la protection que lui assure l’autorité parentale, fait peser sur ses jeunes épaules des responsabilités qu’il n’est pas capable de porter et, finalement, le prive de son enfance. Une fois les parents disqualifiés dans leur rôle éducatif, l’enfant prétendument libéré tombe sous la coupe des réseaux sociaux, de l’État. La primauté éducative des parents est donc un principe à redécouvrir dans l’intérêt de l’enfant et, donc, de la société entière car les enfants sont la société de demain.
Le choix de l’instruction en famille : intervention de Me Veauvy
Dans son intervention, Hubert Veauvy a traité de l’histoire de l’instruction en famille (IEF), consacrée par les lois Ferry et les conventions internationales, et décrit sa remise en cause drastique depuis 2021 par la loi contre le séparatisme. Malgré l’absence de lien prouvé avec la radicalisation, ce régime d’autorisation a divisé par deux le nombre d’enfants en IEF (de 72 000 à 30 000). Maître Veauvy analyse ici des motivations parentales, des dérives (disparités territoriales, arbitraire), et propose des solutions pour restaurer la primauté éducative des parents.
Autres interventions sur ce thème de la primauté des parents comme premiers et principaux éducateurs de leurs enfants
État des lieux
 Claire de Gatellier, Présidente émérite de Famille et Liberté et administrateur de l’institution Jean Cotxet
Claire de Gatellier, Présidente émérite de Famille et Liberté et administrateur de l’institution Jean Cotxet
Elle a constaté que « L’enfant n’a jamais été autant protégé mais également jamais autant menacé », et adresse un appel aux parents pour qu’ils se réapproprient leur rôle et leur responsabilité éducative, et ne l’abandonnent ni à Internet, ni à l’État : « Parents, aimez vos enfants et pratiquez la juste autorité ! »
Fondements philosophiques
 Constance Collin, professeur de philosophie
Constance Collin, professeur de philosophie
Elle a montré que la philosophie s’intéresse depuis Platon à la question de l’attribution de la mission éducative de l’enfant, avec une tension toujours présente entre volonté de l’Etat et rôle des parents.
Si Platon avait développé dans La République la thèse radicale de la prise en charge intégrale par l’Etat de l’éducation des enfants pour en faire les gardiens de la cité, Aristote dans l’Ethique a Nicomaque avait déjà tempéré cette conception : l’éducation est une affaire d’Etat car elle consiste à éduquer l’enfant à la vertu pour la cité, mais la famille est le lieu privilégié pour apprendre la vertu.
Avec saint Thomas d’Aquin, c’est le statut ontologique de l’enfant qui va conférer une priorité éducative aux parents. Celle-ci n’est pas remise en cause même si les parents ne dispensent pas une « bonne éducation ». A sa suite et plus récemment, le philosophe Charles de Konink a postulé qu’on ne peut pas imposer une décision contraire à celle de la volonté des parents. Le droit des parents d’éduquer leurs enfants est inviolable, sauf circonstances particulières telle que la mise en danger de l’enfant ou la nocivité des parents.
Fondements juridiques
 Aurélie Garand, juriste
Aurélie Garand, juriste
Elle a expliqué que la primauté éducative des parents est consacrée par le droit, et en particulier la Convention internationale des droits de l’enfant, dont l’article 18 énonce que : « La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. »
Aurélie Garand adonc invité les parents à affirmer leur droit et le revendiquer : « c’est à l’État de justifier son empiètement sur l’autorité parentale et la primauté éducative, et non l’inverse! ».
 Matthieu le Tourneur, juriste
Matthieu le Tourneur, juriste
Il a exposé le concept d’infantisme qui désigne un système de domination qui existerait contre les enfants. Il explique de quelle manière cette notion est régressive car, comme le dit la Convention des droits de l’enfant, l’enfant a besoin d’une protections spéciale. Or, les promoteurs de la lutte contre l’infantisme préconisent la lutte contre l’autorité parentale, privant ainsi les enfants de la protection dont ils ont besoin.
Il a dénoncé le concept d’infantisme en ce qu’il « fonde les rapports sociaux sur une dynamique de domination et de rapport de force, au lieu d’une logique de don et d’amour ».
 Christophe Foltzenlogel, Juriste à l’European Centre for Law and Justice (ECLJ),
Christophe Foltzenlogel, Juriste à l’European Centre for Law and Justice (ECLJ),
Il a développé l’influence des organisations internationales qui s’intéressent plus à l’engagement des États pour l’alphabétisation, l’égalité garçons-filles, au rôle que les États doivent jouer dans ces domaines, et très peu au rôle des parents.
A partir de l’exemple de l’école à la maison, il a exposé de quelle manière la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme joue sur une fausse opposition entre les prérogatives des parents et les droits des enfants.
Au niveau de l’ONU, les Conventions sont très claires sur la primauté éducative des parents, mais les décisions des Comités ne sont pas toujours respectueuses des principes proclamés, même si le Comité des droits économiques et culturels a clairement critiqué le nouveau système français très restrictif en matière d’instruction en famille.
Il convient de revenir à l’esprit des traités : les parents sont là pour le bien des enfants et, en règle générale, ils aiment bien plus leurs enfants que l’État.
La délégation de l’éducation : pourquoi, à qui, comment ?
 Pascale Morinière, Médecin, Présidente de la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC),
Pascale Morinière, Médecin, Présidente de la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC),
Elle a expliqué que si les parents sont les premiers et principaux éducateurs, ils ne sont pas les seuls, en raison de la dimension sociale de chaque individu.
La délégation de l’éducation est nécessaire, mais seulement de manière partielle et dans un contexte de confiance : sans confiance, il ne s’agit pas d’une délégation mais d’un abandon, un renoncement.
Il n’y a pas une simple complémentarité entre l’école et la famille : les parents sont premiers et l’école est aux côtés des parents dans l’ambition de faire des hommes et des femmes libres. Il faut créer une alliance éducative.
Les parents ne doivent pas être traités comme des adultes de confiance parmi les autres. Ils ont un rôle spécifique et unique.
Le choix de l’école : un droit fondamental des parents
Le choix d’un établissement privé
 Olivia Sarton, Directrice juridique chez Juristes pour l’enfance
Olivia Sarton, Directrice juridique chez Juristes pour l’enfance
Elle a rappelé que « la liberté de l’enseignement est un principe constitutionnel » et que, pour faire valoir un droit à un enseignement privé qui soit une véritable alternative à l’enseignement public, les parents doivent se saisir des conventions internationales pour redonner du contenu et de la vigueur au principe juridiquement reconnu de leur primauté éducative.
Le choix du hors-contrat
 Adeline Le Gouvello, Avocat, Barreau de Versailles
Adeline Le Gouvello, Avocat, Barreau de Versailles
Elle a expliqué que le choix de l’école hors contrat est garanti par les traités internationaux, la constitution, la jurisprudence mais que les contraintes qui s’accumulent sur les établissements libres privent ce droit d’une partie de sa portée. Les élèves scolarisés dans le hors contrat subissent une rupture d’égalité par rapport aux autres élèves : par exemple, ils ne peuvent s’inscrire au concours général, et passent le brevet des collèges dans des conditions plus rigoureuses que les autres puisqu’ils ne bénéficient pas du contrôle continu. Il a été dit que les droits en danger sont ceux qui ne sont pas exercés : le droit au choix de l’enseignement hors contrat est lui un droit vivant, qui ne demande qu’à être exercé.
Pour une collaboration fructueuse parents/école
 Frédéric Gautier, Ancien directeur de l’enseignement catholique de Paris, Médiateur judiciaire et conventionnel.
Frédéric Gautier, Ancien directeur de l’enseignement catholique de Paris, Médiateur judiciaire et conventionnel.
Il a affirmé que, malgré les difficultés, il est possible d’instaurer un dialogue fructueux et donne quelques pistes :
l- les parents doivent déléguer à l’école, sans pour autant renoncer à leur responsabilité parentale ;
– l’école est un lieu tiers entre la famille et la société et représente pour l’enfant un contexte d’altérité ;
– l’enfant est un « bien (bienfait) commun » entre les parents et l’école ; il n’est pas d’abord un problème !
l- le devoir des parents commence à la maison ;
l- les parents et l’école doivent pouvoir faire un choix mutuel éclairé et libre.
l- la collaboration, le vivre ensemble suppose un minimum de points « communs », un socle commun de valeurs entre la famille et l’école.
Quand l’école outrepasse sa mission
 Olivia Sarton, Directrice juridique chez Juristes pour l’enfance
Olivia Sarton, Directrice juridique chez Juristes pour l’enfance
Elle a constaté un raidissement de l’institution, comme le montre la manière dont est organisée l’éducation à la sexualité (signalement systématique de toute contestation).
L’État se sert des difficultés des parents pour prendre leur place : les parents doivent donc s’investir considérablement dans l’éducation de leurs enfants, y compris sur les sujets comme l’EVARS, et relever le défi d’entrer dans un dialogue avec les enfants à l’occasion des enseignements dispensés à l’école.
La liberté pédagogique n’est pas un absolu, et ne peut être invoquée pour imposer n’importe quel contenu.
Aider les parents à (re)devenir éducateurs
 Caroline Carmantrand, Maire-Adjoint à la famille et à la petite enfance (Asnières-sur-Seine)
Caroline Carmantrand, Maire-Adjoint à la famille et à la petite enfance (Asnières-sur-Seine)
Elle a expliqué que l’État fait le choix politique d’externaliser l’éducation : une place en crèche coûte à l’État 2000 euros par mois par enfant, alors qu’une mère en congé parental touche 449 euros par mois. Il y a 9 euros de reste à charge pour la commune par repas pour la cantine.
Ces choix politiques incitent les parents à se reposer sur l’État, et les élus ont le devoir maintenant de refavoriser ce lien entre parents et enfants, par exemple en revalorisant le congé parental (au lieu de dépenser 2000 pour la place en crèche) pour laisser le choix d’abord, et redonner aux familles la possibilité et l’envie de se réinvestir auprès de leurs enfants.
 Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil, initiateur du programme de réussite éducative (PRE)
Xavier Lemoine, Maire de Montfermeil, initiateur du programme de réussite éducative (PRE)
Il a témoigné de ce que les difficultés familiales doivent être réglées avant les difficultés scolaires, car elles en sont souvent le fruit, et de ce qu’il fait en sorte de transformer les lieux de services publics en lieux de confiance.
 Anne-Sophie Biclet, Pédiatre
Anne-Sophie Biclet, Pédiatre
Elle a partagé son expérience que les parents ont une inquiétude de bien faire mais se pensent disqualifiés par les « spécialistes » de tout genre qui leur laissent penser qu’ils sont moins qualifiés alors qu’on apprend à devenir des parents, et qu’il ne faut pas avoir peur d’être parent !
Si le médecin peut agir malgré l’autorité du parent, ce doit être seulement dans des cas extrêmes pour l’enfant. Le médecin peut aussi faire un signalement dans certains cas, mais il ne faut pas en abuser.
 François-Xavier Clément, Ancien directeur d’établissement scolaire, Président d’ALTE Academia
François-Xavier Clément, Ancien directeur d’établissement scolaire, Président d’ALTE Academia
Il a expliqué que le creuset d’une bonne éducation est une conjugalité heureuse.
Les parents doivent assurer leur rôle dès la petite enfance, car ce qui n’a pas été structuré dans les premières années de sa vie risque d’être désordonné ensuite.
L’EVARS doit donner la possibilité aux parents d’être associés au développement des enfants. Il faut leur donner la possibilité de bien faire et des outils existent pour cela, comme les séances cyclo-show et XY.
Des sessions, des groupes de formation (comme les cellules Ichtus) peuvent aussi aider les parents à former les enfants en leur offrant des occasions de discussion, de créer des amitiés.